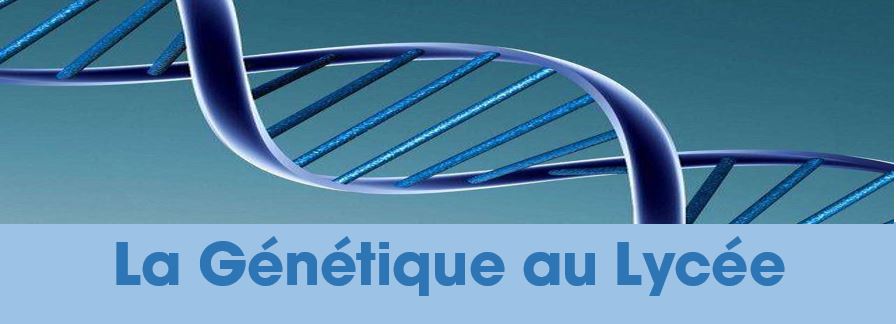THEME 1: L’ADN, SUPPORT DES CARACTERES HEREDITAIRE
Chapitre 1 : Relations entre ADN, protéines et caractères héréditaires
- Quel lien y a-t-il entre les protéines et les caractères héréditaires?
- Quel lien y a-t-il entre les protéines et l’ADN?
Chapitre 2 : ADN et transmission des caractères héréditaires
Chapitre 1 : Relations entre ADN, protéines et caractères héréditaires
1. Quel lien y a t-il entre les protéines et les caractères héréditaires?
Les caractères héréditaires morphologiques, physiologiques et biochimiques, sont tous conditionnés par un polypeptide ou une association de polypeptides formant une protéine. En effet, les protéines jouent un rôle fondamental dans la vie. Sans elles, la vie n’existerait pas ; en fonction du rôle joué dans l’organisme, on en distingue plusieurs types dont:
- les enzymes remplissant des fonctions métaboliques spécifiques. C'est le cas par exemple des enzymes qui assurent la synthèse de la mélanine ( pigment qui détermine la couleur de la peau dans l’organisme humain);
- les protéines de structure qui déterminent la taille de l’individu, la forme d’un organe etc.
- les hormones qui contribuent aux processus de régulation ;
- les anticorps qui interviennent dans le système immunitaire;
- l’hémoglobine qui assure le transport des gaz respiratoires, le collagène qui assure la «cicatrisation » des blessures etc.
2. Quel lien y a t-il entre les protéines et l’ADN?
Les polypeptides, et partant les protéines, sont caractérisés chacun par le nombre, la nature et la séquence des acides aminés qui le composent. Ces trois caractéristiques sont fondamentales ( en plus de l’architecture globale de la molécule bien entendu) pour que le polypeptide ou la protéine puisse jouer le rôle auquel il est destiné dans l’organisme.
Exemple : chez l’espèce humaine, l’hémoglobine se présente sous trois formes : une forme normale dite HbA et deux formes anormales dites HbS et HbC. Chacune de ces deux formes anormales diffèrent de la forme normale par la substitution d’un acide aminé par un autre, parmi les 574 acides aminés que compte la molécule. Cette substitution, apparemment insignifiante ( car ce n’est qu’un acide sur 574 qui est changé) a des conséquences dramatiques sur la fonction de la molécule dans l’organisme : en effet, HbS et HbC sont incapables de transporter convenablement les gaz respiratoires. Si une enzyme subit le même sort ou même plus grave, une amputation d’une des chaînes des polypeptides qui la composent, la réaction qu’elle catalyse, sera aussitôt bloquée ; et la substance finale attendue ne sera pas produite. Le caractère ou les caractères conditionnés par cette substance seront plus ou moins profondément modifiés.
Exemple : l’organisme de tout individu à pigmentation cutanée normale doit produire les enzymes nécessaires à la synthèse de la mélanine . Chez l’albinos, l’organisme est incapable de synthétiser au moins une de ces enzymes.
Il se trouve précisément que ces trois caractéristiques du polypeptide sont déterminées par l’ADN (Acide désoxyribonucléique), constituant principal du chromosome. En effet, ce sont des portions des chaînes de poly nucléotides de l’ADN appelés cistrons qui codent la synthèse des polypeptides. Chaque cistron est formé par une suite de triplets de nucléotides dans un ordre d’agencement rigoureux. A chaque triplet correspond un acide aminé précis si bien que toute modification qui survient au niveau de l’ADN et affectant les cistrons, peut avoir des répercussions sur la structure des polypeptides dont ils codent la synthèse. Les cistrons sont donc, par le rôle qu’ils jouent, les éléments de base responsables de l’apparition des caractères héréditaires : ce sont les unités héréditaires dont l’existence fut devinée pour la première fois par le moine qui les appela « facteurs héréditaires ». Chez les êtres diploïdes, dont l’espèce humaine, la cellule œuf ou zygote résultant de la fécondation, hérite de deux lots de chromosomes, l’un d’origine maternelle et l’autre d’origine paternelle. Cet œuf renferme la totalisé du programme génétique nécessaire à l’édification de l’individu. Le support de ce programme est l’ADN.
ADN et transmission des caractères héréditaires.
Pour que la vie se perpétue, les cellules doivent se reproduire. L’ADN est la molécule qui confère à la cellule cette capacité de reproduction. Elle est la molécule universellement responsable de la transmission des caractères des parents aux descendants. Cette transmission se fait grâce aux gamètes. Une parfaite connaissance des deux modes de divisions cellulaires que sont la mitose et la méiose, est donc un préalable indispensable à la bonne compréhension des mécanismes de transmission des caractères héréditaires et de leurs modifications au cours des générations successives.
Pendant la plus grande partie de la vie de l’organisme, la mitose génère des cellules dont les chromosomes sont identiques en type et en nombre à celui de la cellule mère. Ceci est dû au fait que dans la cellule qui entame la mitose, chaque chromosome est formé par deux chromatides. Ces deux chromatides sont formées de deux molécules d’ADN identiques résultant de la duplication d’une molécule initiale. A la fin de la division, chacune des deux cellules filles hérite exactement de la moitié de l’ADN de sa mère ( à l’anaphase, le clivage du centromère de chaque chromosome, se traduit par la séparation des deux molécules d’ADN qui forment les deux chromatides du chromosome). Ainsi, par la mitose, chaque cellule donne naissance à deux cellules filles portant le même patrimoine héréditaire. Les êtres vivants qui se reproduisent par ce mode de division, engendre des clones.
A l’inverse, la méiose va être à l’origine de la diversité des individus d’une même espèce et ceci, grâce à deux phénomènes qui sont le brassage intrachromosomique d’une part et le brassage interchromosomique d’autre part.
Il convient de rappeler que si deux chromosomes homologues donnés sont morphologiquement identiques, ils sont par contre forcément différents par la structure des molécules d’ADN qui les composent, ce qui n’exclue pas l’existence de cistrons identiques deux à deux le long de ces molécules.
Au cours de la reproduction sexuée, le « hasard » intervient deux fois: une fois au cours de la méiose, et une deuxième fois au cours de la fécondation.
Au cours de la méiose, le « hasard » intervient à la métaphase I, lors de la séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent ; cette séparation qui se fait de façon aléatoire, entraîne une grande diversité de gamètes en fonction du nombre de chromosomes de l’espèce : les individus de chaque espèce produiront chacun 2n types de gamètes différents (n représentant le nombre de paires de chromosomes). Ainsi, chez l’espèce humaine, chaque individu produira 223 types de gamètes différents. Si nous prenons le cas d’un couple qui a un enfant, la probabilité pour qu’il ait un autre enfant identique au premier est de : 1/223 x 1/223 =1/246; et ceci si l’on ne tient compte que de l’effet du brassage interchromosomique.
Il se trouve que le brassage interchromosomique s’exerce sur des chromosomes déjà remaniés par le crossing-over (c.o) au cours de la prophase I. Ainsi, tous les gènes portés initialement par les chromosomes, peuvent grâce au Crossing-over, être «brassés » avec les allèles portés par les chromosomes homologues. En fait, chaque paire de chromosomes porte en général quelques milliers de loci dont une centaine ou plus sont occupés par des couples d’allèles différents. Si on a 100 loci hétérozygotes au niveau d’une paire de chromosomes, 2100 types de gamètes différents peuvent être formés .
En reprenant le cas de l’espèce humaine et en admettant que chaque paire de chromosomes comporte en moyenne 100 loci occupés par des couples d’allèles différents, le nombre théorique d’assortiments de gènes serait (2100)23 = 22300 .
Chaque mâle ou femelle peut donc produire 22300 types de gamètes différents. Le nombre de types d’œufs représentant la descendance théorique de ce couple est de 22300 x 22300 = 24600 . Si nous revenons à l’exemple précédent de notre couple, la probabilité pour qu’il ait deux enfants identiques ( en dehors du cas des vrais jumeaux), est au plus : 1/24600 . Cette éventualité étant presque nulle, chaque être humain est un « exemplaire » unique dans l’univers.
Chapitre 2 : ADN et transmission des caractères héréditaires
Pour que la vie se perpétue, les cellules doivent se reproduire. L’ADN est la molécule qui confère à la cellule cette capacité de reproduction. Elle est la molécule universellement responsable de la transmission des caractères des parents aux descendants. Cette transmission se fait grâce aux gamètes. Une parfaite connaissance des deux modes de divisions cellulaires que sont la mitose et la méiose, est donc un préalable indispensable à la bonne compréhension des mécanismes de transmission des caractères héréditaires et de leurs modifications au cours des générations successives.
Pendant la plus grande partie de la vie de l’organisme, la mitose génère des cellules dont les chromosomes sont identiques en type et en nombre à celui de la cellule mère. Ceci est dû au fait que dans la cellule qui entame la mitose, chaque chromosome est formé par deux chromatides. Ces deux chromatides sont formées de deux molécules d’ADN identiques résultant de la duplication d’une molécule initiale. A la fin de la division, chacune des deux cellules filles hérite exactement de la moitié de l’ADN de sa mère ( à l’anaphase, le clivage du centromère de chaque chromosome, se traduit par la séparation des deux molécules d’ADN qui forment les deux chromatides du chromosome). Ainsi, par la mitose, chaque cellule donne naissance à deux cellules filles portant le même patrimoine héréditaire. Les êtres vivants qui se reproduisent par ce mode de division, engendre des clones.
A l’inverse, la méiose va être à l’origine de la diversité des individus d’une même espèce et ceci, grâce à deux phénomènes qui sont lebrassage intrachromosomique d’une part et le brassage interchromosomique d’autre part.
Il convient de rappeler que si deux chromosomes homologues donnés sont morphologiquement identiques, ils sont par contre forcément différents par la structure des molécules d’ADN qui les composent, ce qui n’exclue pas l’existence de cistrons identiques deux à deux le long de ces molécules.
Au cours de la reproduction sexuée, le « hasard » intervient deux fois: une fois au cours de la méiose, et une deuxième fois au cours de lafécondation.
Au cours de la méiose, le « hasard » intervient à la métaphase I, lors de la séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent ; cette séparation qui se fait de façon aléatoire, entraîne une grande diversité de gamètes en fonction du nombre de chromosomes de l’espèce : les individus de chaque espèce produiront chacun 2n types de gamètes différents (n représentant le nombre de paires de chromosomes). Ainsi, chez l’espèce humaine, chaque individu produira 223 types de gamètes différents. Si nous prenons le cas d’un couple qui a un enfant, la probabilité pour qu’il ait un autre enfant identique au premier est de : 1/223 x 1/223 =1/246; et ceci si l’on ne tient compte que de l’effet du brassage interchromosomique.
Il se trouve que le brassage interchromosomique s’exerce sur des chromosomes déjà remaniés par le crossing-over (c.o) au cours de la prophase I. Ainsi, tous les gènes portés initialement par les chromosomes, peuvent grâce au Crossing-over, être «brassés » avec les allèles portés par les chromosomes homologues. En fait, chaque paire de chromosomes porte en général quelques milliers de loci dont une centaine ou plus sont occupés par des couples d’allèles différents. Si on a 100 loci hétérozygotes au niveau d’une paire de chromosomes, 2100 types de gamètes différents peuvent être formés .
En reprenant le cas de l’espèce humaine et en admettant que chaque paire de chromosomes comporte en moyenne 100 loci occupés par des couples d’allèles différents, le nombre théorique d’assortiments de gènes serait (2100)23 = 22300 .
Chaque mâle ou femelle peut donc produire 22300 types de gamètes différents. Le nombre de types d’œufs représentant la descendance théorique de ce couple est de 22300 x 22300 = 24600 . Si nous revenons à l’exemple précédent de notre couple, la probabilité pour qu’il ait deux enfants identiques ( en dehors du cas des vrais jumeaux), est au plus : 1/24600 . Cette éventualité étant presque nulle, chaque être humain est un « exemplaire » unique dans l’univers.